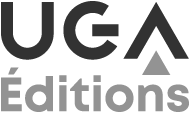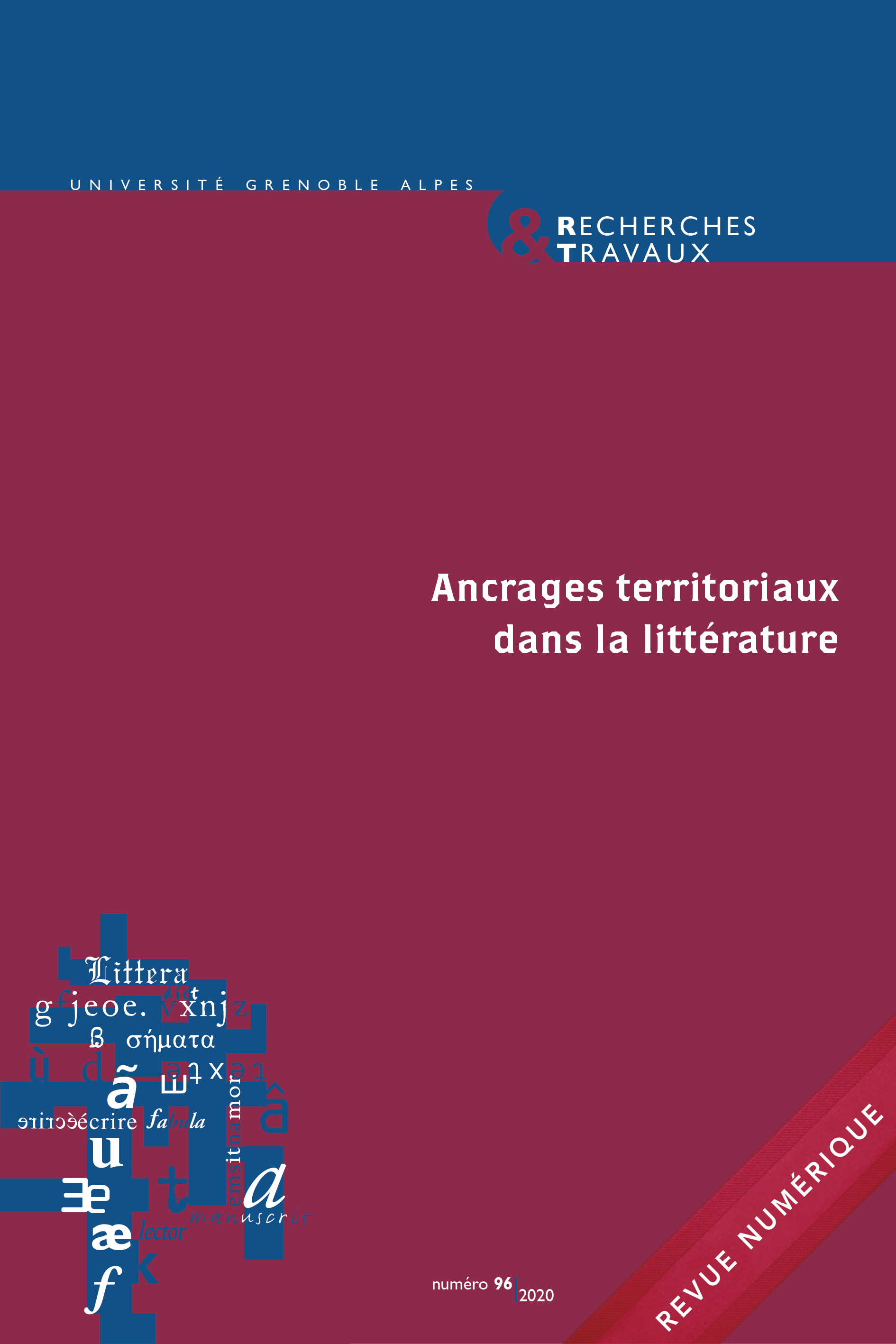Recherches & travaux n° 96 / 2020
Ancrages territoriaux de la littérature
Sous la direction de Mathilde Labbé
Arts/Littérature/Langues, Littérature française, Libellé inconnu, Sciences sociales
Comment l’ancrage géographique de l’écriture oriente-t-il le destin des œuvres littéraires ? Comment les lecteurs s’approprient-ils cette présence dans les lieux qu’ils habitent ? Ce numéro explore la manière dont le territoire peut devenir grille de lecture des textes et dont ce phénomène détermine la construction de la mémoire littéraire.
Présentation
Si le lien entre la création littéraire et les lieux traversés par les écrivaines et écrivains est largement glosé dans les études littéraires comme dans les études géographiques, la manière dont les lecteurs investissent cet ancrage a été peu étudiée. Ce dossier consacré aux ancrages géographiques de la littérature, forme de trivialisation des œuvres au sens d’Yves Jeanneret, envisage la manière dont le territoire peut devenir une grille de lecture des textes et dont ce phénomène, par anticipation, oriente aussi l’écriture. La relation textes-lieux est ici abordée au prisme de motivations multiples : celles des auteurs, mais aussi celles des lecteurs privés, des associations et collectivités, et plus généralement de groupes sociaux constituant vis-à-vis de ces textes des communautés interprétatives. La montée en gloire que constitue la patrimonialisation d’une figure auctoriale (par les anthologies, mais aussi par la survie culturelle dans l’espace urbain via les musées et monuments littéraires) est souvent dépendante de ce lien. Nous nous attachons ici au rôle que joue l’ancrage territorial dans la constitution de l’image des auteurs et autrices, aux usages que les communautés peuvent faire de celle-ci dans la constitution de l’image d’une ville et à la manière dont cette appropriation locale de figures auctoriales informe la mémoire collective de la littérature.
Auteur(s) / Autrice(s)
Mathilde Labbé est maîtresse de conférences en littérature française à l’université de Nantes. Ses recherches portent sur la construction du canon littéraire et la patrimonialisation des œuvres. Elle a codirigé, avec D. Martens, Les Collections de monographies illustrées de poche. Une fabrique du patrimoine littéraire, XIX-XXIe siècles (2016), avec J.-L. Diaz, Les XIXe siècles de Roland Barthes (2019) et coordonne le programme La littérature dans l’espace public. Sa thèse sur la réception de l’œuvre de Baudelaire (Héritages baudelairiens : 1931-2013) est en cours de publication.
Caractéristiques
- Revue Recherches & Travaux
- Éditeur(s) : UGA Éditions
- Date de publication : juin 2020
- Langue(s) : Français
- Éditeur d'origine : UGA Éditions
- Mots-clés : patrimonialisation, territoire, médiation, commémoration, littérature
Revue Recherches & Travaux, les derniers titres
- Recherches & Travaux n° 105 / 2024 Études de réception en pratiques
- Recherches & Travaux n° 104 / 2024 La Nouvelle Vague à la lettre (vol. 2)
- Recherches & Travaux n° 103 / 2023 Littératures de genre et stratégies littéraires
- Recherches & travaux n° 102 / 2023 "Auctor in aula", La leçon des écrivains, "When Writers Are Literature Professors"
- Recherches & travaux n° 101 / 2023 La Nouvelle Vague à la lettre (Vol. I)
- Recherches & travaux n° 100 / 2022 Les arts littéraires : transmédialité et dispositifs convergents
- Recherches & travaux n° 99 / 2021 Penser le retour de l’éloquence et de son enseignement
- Recherches & travaux n° 98 / 2021 Raconter, décrire, intervenir : la politique du reportage
- Recherches & travaux n° 97 / 2020 Papa se meurt, maman est morte : quand l’écrivain·e devient orphelin·e
- Recherches & travaux n° 96 / 2020 Ancrages territoriaux de la littérature
Publié le 26 juin 2020
Mis à jour le 14 mai 2022
Mis à jour le 14 mai 2022